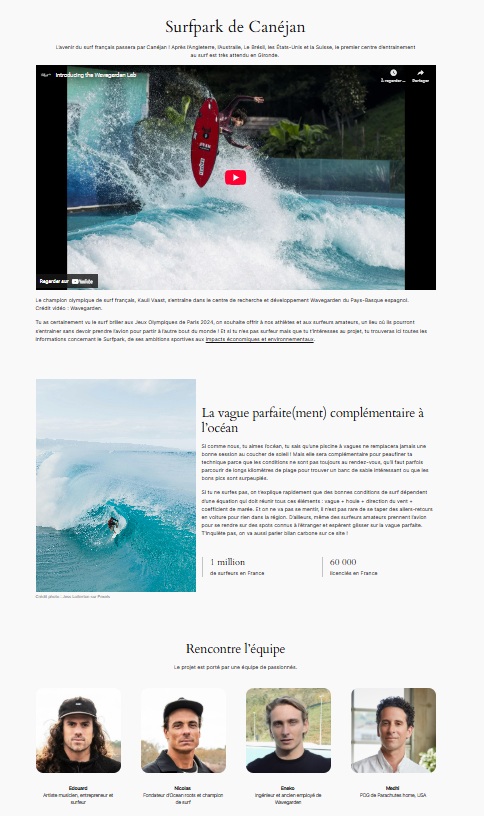Avis publié le 25 mars 2025
SURFPARK CANEJAN – 1045/25
Plainte partiellement fondée /Demandes de révision rejetées
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- après avoir entendu d’une part les représentants de l’association Collectif Canéjan en transition et de la Société pour l’Étude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Gironde, cette dernière assistée de son avocate et d’autre part, les représentants du Surfpark de Canéjan (SCI Paola et société Fréquence SAS), lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
- après en avoir débattu,
- l’avis délibéré ayant été adressé à l’annonceur et aux associations plaignantes, lesquels ont respectivement introduit une demande et un recours en révision, rejetés par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 18 novembre 2024, d’une plainte émanant de l’association « Collectif Canéjan en transition » et de la Société pour l’Étude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Gironde, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité pour promouvoir l’implantation d’un Surfpark sur la commune de Canéjan, en Gironde.
Les allégations de la campagne publicitaire mises en cause par le collectif sont :
- Sur le site Internet du Surfpark : « On gère les ressources : c’est une évidence», « Il n’y aura pas un besoin d’artificialisation du sol puisque le Surfpark réhabilitera le site d’une ancienne friche industrielle. […] Il n’est pas question de bousiller l’environnement alors même que notre terrain de jeu favori c’est l’océan, lui-même largement menacé par la pollution et le dérèglement climatique. Les surfeurs n’ont pas toujours un bon bilan carbone mais ils aiment la nature et savent qu’ils doivent la préserver. », « Ce projet va-t-il détruire des terres naturelles ou agricoles ? : « On réhabilite un vieux site pour le transformer en un lieu fun et écoresponsable, tout en replantant des arbres pour verdir encore plus la zone. », « Ce projet va-t-il détruire des terres naturelles ou agricoles ? : « Absolument pas ! Le Surfpark sera construit sur une friche industrielle, ce qui évite de toucher aux espaces naturels. », « L’eau des bassins risque-t-elle de polluer l’environnement en cas de déversement ? : « Non, pas du tout ! Si un déversement devait se produire (par exemple après une grosse pluie), l’eau rejetée serait aussi propre que celle du robinet. », « Que se passera-t-il en cas de vidange des bassins ? : « En cas de vidange exceptionnelle (très rare), l’eau des bassins sera rejetée […] cette eau, traitée avec soin, serait aussi propre que celle du robinet ! », « Nos chiffres proviennent du constructeur Wavegarden […]. Aujourd’hui, il y a 7 parcs Wavegarden dans le monde et autant de données qui peuvent être analysées. », « notre Surf Park utilisera moins d’eau qu’une piscine municipale. », Le Surfpark va-t-il changer le cadre de vie des habitants de Canéjan et Cestas ? : « Le parc est conçu pour s’intégrer parfaitement à la vie locale, sans nuisances sonores ni visuelles. […] Ce projet, c’est l’occasion de créer un nouvel espace de détente sans perturber la tranquillité du coin. », « Club affilié à la Fédération Française de surf. » « Surf scolaire : Un projet pédagogique idéal validé par l’éducation nationale […]. »..
- Dans la vidéo diffusée sur Youtube et sur le réseau social Instagram : « c’est un projet audacieux qui finalement s’inscrit dans la transition écologique grâce à la réhabilitation d’une friche industrielle, […] », « Donc il y a 200 000 personnes dans chaque endroit, chaque région où il y a un Surfpark, qui ont le besoin, qui ont cette nécessité d’aller vivre leur passion, faire leur sport. A partir de là ça permet de remettre un petit peu en balance les données et le volume d’une pétition ou d’un réel besoin. », « Aujourd’hui sur le terrain ça fait 40 ans que l’eau est gaspillée. Elle tombe sur ces toitures industrielles. Elle retourne directement à l’océan… », « c’est un projet audacieux qui finalement s’inscrit dans la transition écologique… », « L’innovation grâce à ces nouvelles technologies va nous permettre d’avoir réellement un impact environnemental réduit et donc d’être exemplaires dans la transition écologique. », « Aujourd’hui on nous reproche d’avoir, dans notre vidéo de présentation, dit qu’on n’avait pas déboisé mais réhabilité. En fait si on revient à la définition du terme déboiser c’est vraiment dégarnir un terrain de sa forêt, de ses bois. Bah je confirme : on n’a pas déboisé parce qu’il y avait pas de forêt sur ce terrain. […] Dire qu’on est allés déboiser, c’est vraiment mensonger. », « […] c’est vrai que c’est un projet audacieux qui finalement s’inscrit dans la transition écologique grâce à […] la récupération d’eau de pluie ou même station photovoltaïque sur des bâtiments existants pour combler la totalité du besoin. », « La norme Afnor est une norme expérimentale qui permet de poser les bases sur lesquelles le développement de piscines à vagues peuvent être basées. Partant de là, nous avons appliqué tous ces critères-là, sauf que, vu qu’elle est expérimentale, nous l’avons même améliorée. L’eau de baignade classique, elle demande une vidange annuelle, un renouvellement du volume d’eau de 3 à 5% par jour. Ce qui est un énorme gaspillage d’eau. On va éviter ce gaspillage là en se classant en tant qu ‘ « activité nautique », « Aujourd’hui, voilà, on propose de produire 120% de l’énergie qui sera consommée sur le Surfpark. […] En fait, ça consomme l’équivalent de trois voitures électriques qui se rechargent en même temps. », « On a prévu dans le projet en fait d’installer une grande station photovoltaïque. […] C’est vraiment le top de ce qu’on peut faire […] », « Donc en fait il n’y a jamais 3000 personnes qui arrivent en même temps [en automobile] donc il n’y aura pas d’impact sur les lotissements de Cestas ou de Canéjan. Ils ne verront aucune différence. », « [B-Corp] est un label international qui récompense les entreprises qui sont exemplaires. […] Donc en fait nous, c’est un objectif, on sait qu’au bout de quelques années d’exploitation on pourra obtenir cette certification. »
- Un flyer : « Canéjan, précurseur en termes de transition écologique : « Ce projet innovant permet une autonomie en eau et en énergie. », « il [le Surfpark] ne génèrera aucune nuisance sonore au-delà de 50 mètres, ni de circulation ou de stationnement […] », « Canéjan soutient ses jeunes et ses associations en prenant la vague du développement économique » « Canéjan, précurseur en termes de transition écologique ».
2. Les arguments échangés
– L’association plaignante relève que cette campagne contrevient à plusieurs règles de déontologie publicitaires édictées par l’ARPP en matière de développement durable :
- Sur la valorisation d’un défrichement: l’annonceur valorise à plusieurs reprises le défrichement et l’artificialisation d’une parcelle boisée, en employant des termes disproportionnés tels « écoresponsable », « transition écologique » ou « verdir ». Ce défrichement est qualifié par l’annonceur de « réhabilitation d’une friche industrielle ». Il n’aurait impliqué ni artificialisation du sol ni de « bousiller » l’environnement, mais permettrait au contraire de « verdir encore plus la zone », s’inscrivant ainsi dans la transition écologique. Cependant, il s’agit en réalité de construire des bâtiments et de creuser deux immenses piscines couvrant une superficie de 1,35 ha sur un terrain largement boisé. Enfin, en expliquant que les surfeurs « n’ont pas toujours un bon bilan carbone mais qu’ils aiment la nature », l’annonceur sous-entend que les émissions de carbone seraient, d’une certaine façon, contrebalancées par cet amour de la nature. Il valorise donc des comportements contraires à la protection de l’environnement (1.1a).
- Sur le « réel besoin » d’un Surfpark : l’annonceur explique qu’aller surfer dans un Surfpark comme celui envisagé à Canéjan représenterait un « réel besoin » pour les surfeurs. Justifier la construction d’un tel complexe en invoquant avec insistance (cf. l’adjectif « réel » qui renforce le nom « besoin », également qualifié de « nécessité ») semble problématique, en faisant passer une activité récréative qui n’existait pas jusque-là comme une nécessité impérieuse, quasiment vitale. L’annonceur incite donc directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs ou contraires aux principes de l’économie circulaire (1.1b).
- Sur la valorisation du prélèvement d’eau de pluie : l’annonceur explique que l’eau qui tombe sur les toits est « gaspillée » et « retourne directement à l’océan », omettant ainsi l’importance de l’eau de pluie pour les écosystèmes terrestres. En réalité, même lorsqu’elle tombe sur des toits, l’eau de pluie s’écoule ensuite vers des fossés, zones humides, rivières et fleuves, où elle joue un rôle écologique essentiel. La rivière voisine du site, l’Eau Bourde, est d’ailleurs menacée par des étiages de plus en plus bas en période estivale. Récupérer l’eau de pluie peut certes permettre d’économiser l’eau potable, un objectif louable, mais le justifier en invoquant un supposé gaspillage de l’eau nous semble problématique. L’annonceur minimise donc les conséquences de la consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement (1.1c).
- Sur la présentation du projet s’inscrivant dans la transition écologique: la transition écologique vise à transformer notre mode actuel de production et de consommation en un modèle plus respectueux de l’environnement et plus durable. Or, le projet présenté consiste à construire un Surfpark pour y pratiquer le surf sur des vagues générées artificiellement dans d’immenses piscines d’une superficie équivalente à 11 piscines olympiques. Cela entraînerait inévitablement un mode de consommation du surf moins écologique que sa pratique en milieu naturel, puisqu’il dépendrait d’une infrastructure spécifique (une piscine de surf), dont la construction et le fonctionnement auraient incontestablement un impact environnemental. Expliquer qu’un tel projet s’inscrit dans la transition écologique revient à discréditer ses principes et objectifs. La publicité discrédite donc les principes et objectifs, ainsi que les conseils ou solutions, communément admis en matière de développement durable (1.2).
- Sur le déboisement: le terrain destiné à la construction du Surfpark était constitué d’un boisement de chênes et d’un ancien parking arboré. Au cours de l’hiver 2022-2023, les arbres ont été abattus puis dessouchés. Une autorisation préfectorale de défrichement a bien été demandée et obtenue par la Sci Paola en 2022 pour une partie du terrain. La notion de défrichement est précisée par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code forestier. Le défrichement y est défini comme la destruction de l’état boisé d’un terrain [c’est à dire son déboisement] et la suppression de sa destination forestière. La caractérisation de l’état boisé et de la destination forestière résulte d’une constatation de fait et non de droit : il est donc indifférent que les terrains fassent l’objet d’un classement particulier par un document d’urbanisme (3). Le déboisement est donc bien avéré. L’annonceur induit donc le public en erreur sur la réalité de ses actions (2.1)
- Sur la qualité de l’eau des piscines: l’affirmation selon laquelle l’eau rejetée serait aussi propre que celle du robinet est injustifiable. En réalité, il s’agit en partie d’eau de pluie, donc non potable. Cette eau est traitée par des désinfectants et est exposée à des pollutions issues des combinaisons des surfeurs (en néoprène notamment), de la cire pour leurs planches, et de divers produits cosmétiques. La comparaison avec l’eau du robinet est trompeuse et potentiellement dangereuse, en suggérant à tort que l’eau des bassins serait potable. L’annonceur induit donc le public en erreur sur les réalités de ses actions (2.1) et ne peut justifier correctement son affirmation (2.3), les éléments techniques prouvant le contraire.
- Sur l’autonomie du Surfpark en eau et en énergie: l’affirmation sur l’autonomie en eau est incorrecte. Tout d’abord, les porteurs de projet ont eux-mêmes estimé un besoin moyen annuel en eau potable du réseau de 13 318,85 m3/an pour les activités annexes (ex. douches). Or, il n’est pas précisé s’il est question des besoins des seuls bassins. De plus, les porteurs de projet ont admis qu’il serait nécessaire d’utiliser de l’eau potable pour le premier remplissage des piscines. Enfin, en cas de vidange, recommandée par le constructeur au moins tous les 2-3 ans pour raisons techniques, il faudrait de nouveau remplir les bassins avec de l’eau potable. Il est donc inexact de prétendre que la récupération d’eau de pluie comblera tous les besoins. De même, l’affirmation d’autonomie en électricité est incorrecte. Les porteurs de projet expliquent en effet qu’ils auront recours au réseau public d’électricité en hiver, au moment des pics de consommation annuelle. Cette dépendance implique une absence d’autonomie, puisque celle-ci est définie comme le « caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d’autre chose » (Larousse). L’annonceur induit donc le public en erreur sur les réalités de ses actions (2.1) et ne peut justifier correctement son affirmation (2.3), les éléments techniques prouvant le contraire.
- Sur la norme Afnor : les porteurs de projet ne comptent pas appliquer la norme Afnor XP S 52-900 « Installations de vagues pour le surf » pour leur projet de Surfpark à Canéjan. Ils justifient leur choix en affirmant que la norme serait trop contraignante en soumettant ces installations à la réglementation des Piscines du code de santé publique. Cela impliquerait une vidange annuelle et le renouvellement de 3% à 5% du volume d’eau des bassins chaque jour, entraînant un « gaspillage ». Cependant, cette affirmation est inexacte. La norme Afnor en question exige en réalité d’appliquer la réglementation des Baignades artificielles, qui est moins contraignante que celle des Piscines. L’annonceur induit donc le public en erreur sur les réalités de ses actions (2.1) et ne peut justifier correctement son affirmation (2.3), les éléments techniques prouvant le contraire.
- Sur l’emploi d’affirmations chiffrées: celles-ci sont impossibles à vérifier. Les chiffres de consommation d’eau ou d’énergie fournis par le constructeur Wavegarden n’ont pas été rendus publics, la consommation d’eau d’une piscine municipale est très variable, et il est impossible de vérifier l’affirmation selon laquelle la consommation électrique du Surfpark serait équivalente à celle de trois voitures électriques sans disposer du modèle de chargeur électrique utilisé. La puissance d’un chargeur peut varier de 7 kw pour un modèle standard à plus de 150 kw pour un chargeur rapide. L’annonceur n’est pas en mesure de présenter l’origine des résultats annoncés et la méthodologie ayant servi de base de calcul (2.3).
- Sur le dispositif solaire : dans la vidéo, l’installation photovoltaïque est qualifiée de « top de ce qu’on peut faire ». Cette affirmation paraît disproportionnée, d’autant que, juste après (05:02), il est précisé que l’installation ne produira pas assez d’électricité l’hiver et devra recourir au réseau public. Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles (3.1).
- Sur l’absence totale de nuisances pour les riverains : ces affirmations, suggérant une absence complète de nuisances (notamment sonores) liées au Surfpark et au trafic routier qu’il engendrerait, sont indéfendables. Si le Surfpark voyait le jour, de nombreux événements impliquant l’utilisation de haut-parleurs y seraient organisés (compétitions, spectacles, concerts…), pas nécessairement lors des pics de circulation automobile. Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif (3.3).
- Sur l’utilisation de l’image d’autres structures : dans sa communication, l’annonceur met en avant, directement ou indirectement, différents organismes (la commune de Canéjan, l’éducation nationale, la Fédération Française de Surf, l’organisme écocertificateur B-Corp, voire la norme Afnor) disposant d’une image positive en matière de développement durable, et ceci sans autorisation de leur part. Dans le cas de la commune de Canéjan, le procédé est indirect, mais l’annonceur semble bien s’exprimer au nom de la commune (« Canéjan soutient ses jeunes et ses associations… »). Le Canéjan Surf Club n’est pas à ce jour affilié à la Fédération Française de surf, et il n’y a pas à notre connaissance de projet pédagogique validé par l’éducation nationale. L’annonceur affiche le logo de B-corp sur la couverture du post Instagram (voir ci-contre) et sur la deuxième page du flyer sans autorisation. L’annonceur associe ainsi sans fondement toutes ces structures à son projet aux yeux du public. Enfin, il présume qu’il obtiendra la certification B-Corp, bien que cela ne soit nullement assuré. L’annonceur utilise ces noms et logos de manière à suggérer sans fondement une approbation officielle ou une certification par un tiers (6.2), et dans le cas de la certification B-Corp il ne peut justifier correctement son affirmation (2.3).
Outre les points soulevés plus haut, le message exprime sans preuve une promesse globale (ex. « exemplaires dans la transition écologique », règles 2.4 et 3.3). Par ailleurs, le message apparaît souvent disproportionné (« exemplaire », « le top » … ; règle 3.2) et manque parfois de clarté, par exemple sur la consommation en eau qui serait « la plus basse […] possible » (01:33 ; règle 4.6). Enfin, le vocabulaire utilisé (« aucun », « jamais », « parfaitement », etc.) tend à fréquemment gommer l’existence d’impacts négatifs (cf. règle 7.4).
– Les représentants du Surfpark (SCI Paola et société Fréquence SAS) ont été informés, par courriel avec accusé de réception du 12 décembre 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Les porteurs du projet expliquent tout d’abord n’avoir pas répondu à la première plainte par manque de temps et parce qu’ils considéraient celle-ci comme une tentative de déstabilisation du projet et comme un prétexte pour le collectif de se faire entendre.
Néanmoins, ils tiennent à affirmer leur profond attachement au respect des principes déontologiques édictés par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité.
Conscients de la nécessité d’être transparents et précis dans leurs messages, les représentants de la société ont engagé des actions concrètes pour aligner leur communication avec les Recommandations pour la déontologie publicitaire :
– des propositions de modifications de l’ensemble des passages litigieux visant à préciser les éléments techniques ou nuancer certaines affirmations jugées excessives.
Par exemple :
- La présentation de l’impact environnemental a été reformulée pour éviter toute ambiguïté sur la réalité du défrichement autorisé par la préfecture.
- Les énoncés relatifs à la qualité de l’eau des bassins et à leur impact potentiel sur l’environnement ont été précisés en s’appuyant sur les études et avis des autorités compétentes (Agence Régionale de Santé).
- Les mentions relatives à l’autonomie en eau et en énergie ont été ajoutées pour refléter fidèlement les données disponibles et les limitations actuelle
- Quant au flyer, il a déjà été distribué aux riverains.
Les porteurs du projet affirment par ailleurs que tous les arguments “marketingˮ sont fondés sur des documents validés dans le cadre du permis de construire ou d’études indépendantes.
Ils reconnaissent toutefois que certaines formulations employées ont pu apparaître maladroites, notamment lorsqu’elles traduisent un enthousiasme sincère mais insuffisamment nuancé. À titre d’exemple, l’emploi du terme « écoresponsable » a pu laisser entendre une absence totale d’impact environnemental, ce qui n’était pas l’intention.
Ils annoncent que ces déclarations seront corrigées pour refléter avec justesse la réalité du projet, qui s’appuie sur des données techniques validées par les différentes autorités compétentes.
Les porteurs du projet affirment que leur ambition reste de répondre à un besoin sportif tout en limitant au maximum l’impact environnemental du projet. Il a été, dès le début, privilégié une approche fondée sur :
- La valorisation d’une friche industrielle existante, dans le cadre d’une zone d’activité déjà largement artificialisé
- La réduction de la consommation de ressources par des solutions innovantes, telles que l’utilisation d’eaux pluviales et la création d’un stockage de ces eaux pour remplir partiellement les bassins et les maintenir à niveau complètement.
- Le respect des règles et normes environnementales, validées par les autorités compétentes dont l’ARS, la DREAL et la DDTM.
Plus précisément, pour répondre aux différents points soulevés par la plainte, les porteurs du projet ajoutent que :
- Sur la valorisation du défrichement : la friche industrielle appartient à un ensemble classé par le Plan Local d’Urbanisme de Canéjan en zone d’activité économique. La fiche industrielle et le parking ont été transformés en Zone Industrielle. En termes de superficie, les zones du Courneau 1 et 2 ont une superficie d’environ 50 hectares. Le Surfpark a obtenu l’autorisation de défricher sur 5000m2. Le reste n’a pas été considéré comme un boisement par le passage de la DDTM. Une étude 4 saisons vient définitivement contester les arguments des associations.
- Sur le « réel besoin » dʼun Surfpark : cet argument est totalement hors-sujet avec la plainte déposée. La Fédération de surf exprime son intérêt sportif pour ce type de centre d’entraînement. Les surfeurs professionnels français partent plusieurs fois par an en stage dans des centres comme celui que nous souhaitons développer.
- Sur la valorisation du prélèvement dʼeau de pluie : Les associations font un amalgame douteux entre les effets naturels et bénéfiques de la pluie tombant sur des terres naturelles et de la pluie qui ne peut plus s’infiltrer naturellement sur des zones artificialisées et qui est donc redirigée vers des solutions de gestion des eaux pluviales. Dans le cas du Surfpark, ces eaux récupérées sont artificiellement envoyées dans un bassin tampon d’où elles s’évaporent ou rejoignent la rivière pour finir dans l’océan. Il n’y a rien de naturel à ce processus. Le projet propose de valoriser cette ressource pour éviter de puiser dans le réseau d’eau potable. L’étude 4 saisons indépendantes vient confirmer cela ainsi que les avis des services de l’État.
- Sur la question « Un projet s’inscrivant dans la transition écologique ? » : aucune preuve n’est apportée par les plaignants pour dire que c’est un mode de consommation moins écologique ! Leurs arguments consistant à dénigrer systématiquement le projet prouvent leur méconnaissance totale de ce sport en France et le contexte dans lequel il est pratiqué aujourd’hui. Même si cela est difficile à évaluer, de nombreux habitants de la métropole bordelaise se déplacent à l’océan pour pratiquer le surf. La pratique du surf explose et les “spotsˮ (du Verdon jusquʼà Biscarrosse en passant par Carcans et Lacanau) sont saturés, c’est une réalité. Le Surfpark apporte une réponse à un problème grandissant et dont le secteur professionnel du surf a parfaitement conscience. Si ce besoin n’existait pas, il n’y aurait aucune raison de prendre un risque à créer une entreprise qui nécessite un lourd investissement dans les infrastructures. La transition écologique vise à évoluer vers un modèle économique et social qui apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux. Il est utile de rappeler ici que cette transition ne signifie pas d’abandonner la création d’entreprise mais de faire en sorte que de projets, comme le centre d’entraînement, puissent prendre en compte ces enjeux en prévoyant dès leur conception la réduction de la consommation d’énergie et une part d’énergies renouvelables significative.
- Sur le déboisement : le défrichement concerne une petite partie de 5000m2 en bas du terrain. Ce terrain a un PLU économique depuis 50 ans et a été largement artificialisé pendant plusieurs décennies. Les associations ne mentionnent volontairement pas que plus de 50 hectares autour ont été construits sur d’autres anciens parkings ou même des espaces boisés. On ne peut pas raisonnablement parler de déboisement sur un terrain de cette nature. Et la société affirme n’avoir jamais tenté de cacher que des arbres avaient été coupés. L’argument des plaignants est infondé.
- Sur l’argument selon lequel l’eau des piscines serait « aussi propre que celle du robinet » : la formulation est maladroite mais l’idée était simplement de rassurer les futurs usagers sur la qualité de l’eau des bassins tant pour la pratique du surf que pour les éventuels rejets dans les écosystèmes environnants. Il est évident que la qualité de l’eau doit répondre à des normes en vigueur pour éviter toute contamination bactérienne ou intoxication, au cas où elle serait ingérée accidentellement. L’ARS et le Ministère de la santé ont validé les systèmes de filtration et de désinfection de l’eau. Ces autorités feront tous les contrôles nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et de l’environnement immédiat du Surfpark, comme elles le font pour d’autres installations sportives. Par ailleurs, aucun problème sanitaire n’a été déploré dans les autres installations du constructeur Wavegarden.
- Sur l’autonomie du Surfpark en eau et en énergie : Les porteurs du projet a fourni toutes les informations dans le permis de construire, dans les articles de presse et dans les premières vidéos du projet. Il était allégué une autonomie pour le maintien des bassins et non pas pour les besoins du bâtiment (vestiaires, toilettes, etc). Les vidéos promotionnelles ne vont pas reprendre l’ensemble des données techniques données aux autorités, c’est absurde. Concernant la vidange des bassins tous les deux ou trois ans, cela reste une préconisation du constructeur. Le centre d’entraînement “The Waveˮ à Bristol, qui utilise la même technologie que celle du futur centre de Canéjan, nʼa réalisé aucune vidange de son bassin en 5 ans. Concernant la consommation électrique, il est question d’autonomie en expliquant qu’il faut prendre en compte un lissage annuel de la production d’électricité et de la consommation électrique qui a été évaluée.
- Sur l’argument relatif à la norme Afnor : celle-ci est expérimentale. Rien n’est pour l’instant approuvé par les services de l’État. Même si elle pose les premières bases des réglementations des surfparcs, il y a encore du travail, notamment sur la classification des bassins Une révision de cette norme est d’ailleurs en cours et l’équipe du Surfpark de Canéjan a été sollicité par lʼAfnor pour apporter un retour dʼexpérience sur le travail qui a été mené avec lʼARS.
- Concernant les affirmations chiffrées invérifiables : les autres parcs Wavegarden ne communiquent pas officiellement sur leurs consommations en eau. Dans un article de “Wavepool mag”, le parc de Bristol donne une estimation. “Le Surfpark « The Wave » à Bristol a indiqué que le taux d’évaporation nette de son bassin à vagues variait chaque année, mais que la quantité d’eau consommée était en moyenne équivalente à celle utilisée pour arroser un gazon d’une surface équivalente destiné à des activités sportives de haut niveau. Ce qui, dans ce cas, correspondrait à un terrain de sports de 1,8 hectare. La société a ajouté que le volume d’eau utilisé ne représentait que 6 % de celui nécessaire à l’irrigation d’un terrain de golf à 18 trous sur une année entière.ˮ Ils ont confirmé que les bassins de Canejan étaient dans les bonnes fourchettes de consommation. Un expert nommé par le tribunal est d’ailleurs en ce moment même en train de mener un audit sur les chiffres annoncés par les 2 camps et leurs écarts. Il serait dommage de se prononcer alors que dans 3 mois, un rapport officiel viendra définitivement éclairer le débat et montrer qui le plus proche de la réalité. Pour les bornes de recharges, il a été précisé qu’il s’agissait de bornes charge rapide de 150 kw.
- Sur le dispositif solaire : le mot « top » est sorti de son contexte. La phrase dit que l’on suit les recommandations de la SEPANSO : « Pour la SEPANSO Gironde, le développement de l’énergie solaire photovoltaïque doit être privilégié sur les toitures et les zones déjà anthropisées. ». Il y a donc un détournement d’un message qui est lui-même porté par la même association plaignante. Avoir besoin du réseau public ne constitue pas un problème, cela est écrit dans le permis de construire depuis le début. Les porteurs du projet souligne l’effort effectué (alors que celui-ci n’est absolument pas obligatoire) en prévoyant une station photovoltaïque qui produira en moyenne sur l’année, plus d’énergie que ce que le projet consommera. Il faut garder en tête la notion d’échelle annuelle pour justifier l’autonomie et non journalière.
- Sur l’absence totale de nuisances pour les riverains : ces allégations sont fausses et aucune preuve n’est apportée par les associations. Lors d’évènements sportifs exceptionnels, des haut-parleurs seront utilisés dans le cadre défini par la loi, pour éviter toutes nuisances sonores au-delà de 700m, distance des premières habitations. En outre, l’autoroute A63 est à quelques mètres et la nuisance est avérée, 24 heures sur 24. Les parkings surdimensionnés déjà existants seront en capacité de recevoir les usagers, même en cas d’évènements organisés sur le centre d’entraînement. Lʼargument de la nuisance liée à la circulation routière ne tient pas, dans la mesure où :
- 4000 à 5000 personnes travaillaient sur le site Solectron au pic de l’activité, y’avait t-il des plaintes sur les nuisances routières à cette époque ?
- il existe une bretelle dʼautoroute qui dessert directement la zone dʼactivité du Courneau, qui permet dʼéviter largement le passage devant des habitations ;
- il ne s’agit que de 300 personnes en moyenne par jour ;
- il existe une ligne de bus qui dessert la zone du Courneau et une piste cyclable facilement accessible depuis peu reliant les villes alentour.
- Concernant l’argument relatif à l’utilisation de l’image d’autres structures : les porteurs du projet soutiennent n’avoir à aucun moment affirmé que le futur centre d’entraînement est d’ores et déjà certifié B-corp mais ont seulement fait part de ce que ce projet aurait vraisemblablement cette certification et de ce que le centre de Bristol l’avait déjà obtenue.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :
- au titre des impacts éco citoyens (point 1) :
- « 1. La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :
(…)
c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement. »
-
- 1.2 La publicité ne doit pas discréditer les principes et objectifs, non plus que les conseils ou solutions, communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.
- au titre de la véracité des actions (point 2) :
- « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
- 3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité ; / Pour tout message reposant sur une allégation scientifique, l’annonceur doit être en mesure de présenter l’origine des résultats annoncés et la méthodologie ayant servi de base de calcul. / La publicité ne peut recourir à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne seraient pas conformes à des travaux scientifiques reconnus (…) »
- au titre de la proportionnalité (point 3) :
-
- 3.1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles. La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit.
- 3.2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion.
- 3.3 En particulier :
a/ L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié.
b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.
c/ La présentation d’action(s), de produit(s) à un stade expérimental ou de projet (prototype, R&D, investissement…) doit clairement les présenter comme tels et ne pas en exagérer la portée.
- au titre de la « clarté du message » (point 4) :
- « 4.2 Si l’argument publicitaire n’est valable que dans un contexte particulier, ce dernier doit être présenté clairement.
- 4.6. Tout argument de réduction d’impact ou d’augmentation d’efficacité doit être précis et s’accompagner de précisions chiffrées, en indiquant la base de comparaison utilisée ».
- au titre des « Signes, labels, logos, symboles, auto-déclarations »
-
- 1 Les signes ou symboles ne peuvent être utilisés que si leur origine est clairement indiquée et s’il n’existe aucun risque de confusion quant à leur signification.
Les précisions sur cette signification pourront être apportées aux conditions définies par l’article 4-3 de ce texte.
-
- Ces signes ne doivent pas être utilisés de manière à suggérer sans fondement une approbation officielle ou une certification par un tiers.
-
- La publicité ne doit pas attribuer aux signes, logos ou symboles une valeur supérieure à leur portée effective.
- Le recours à des logos d’associations, fondations ou tout autre organisme ne doit pas créer de lien abusif entre le partenariat engagé et les propriétés du produit ou de l’action présenté.
- au titre du « vocabulaire » (point 7) :
-
- « 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable.
- 2 Lorsque les termes et expressions utilisés font l’objet d’une définition fixée par une norme, ils doivent être employés dans un sens qui correspond à cette définition.
- 3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”.
- 4 Les termes, expressions ou préfixes utilisés ne doivent pas traduire indûment une absence d’impact négatif du produit ou de l’activité de l’annonceur.
- 5 Le vocabulaire technique, scientifique, ou juridique, peut être utilisé s’il est approprié et compréhensible pour les personnes auxquelles s’adresse le message publicitaire.
- au titre de la « présentation visuelle et sonore » (point 8) :
- « 8.4 Lorsque la publicité utilise un argument écologique, l’assimilation directe d’un produit présentant un impact négatif pour l’environnement à un élément naturel (animal, végétal, …) est à exclure. »
Le Jury relève que la plainte est dirigée contre diverses allégations figurant sur le site Internet publié par la SAS Fréquence pour promouvoir le projet de « l’Académie de la glisse » à Canéjan, consistant en la création d’un espace aquatique offrant des vagues artificielles permettant aux adeptes du surf de s’entraîner hors de l’océan.
La plainte vise également une vidéo intitulée : « interview podcast Surfpark » qui est mise en ligne sur ce même site, mais également accessible sur youtube et instagram. D’une durée de dix-huit minutes, elle met en scène, dans un local évoquant un studio d’enregistrement, une jeune femme se présentant comme habitante de Canéjan, et qui pose tour à tour, aux trois porteurs du projet (« Edouard », « Nicolas » et « Eneko »), des questions sur les points du projet ayant pu susciter des critiques, notamment s’agissant de ses impacts environnementaux.
Enfin, la plainte porte sur un flyer, distribué aux habitants de Canéjan : « SURFPARK CANEJAN / Un Surfpark à Canéjan : Un projet responsable et bénéfique au plus grand nombre », lequel renvoie par ailleurs au site internet du projet.
L’association « Collectif Canéjan en transition » soutient que la campagne promotionnelle présente différents manquements à la Recommandation « développement durable », principalement s’agissant de ses impacts éco-citoyens, de la véracité des actions entreprises et de la proportionnalité des messages.
- Sur les impacts éco-citoyens :
Il convient d’observer à titre liminaire que la première partie de la Recommandation développement durable (« impacts éco-citoyens ») a plutôt vocation à s’appliquer aux publicités ne mettant pas en avant d’arguments environnementaux. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il est précisé en introduction du « 1. » de la Recommandation : « Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. »
Au demeurant, il est permis d’ajouter qu’en principe, une publicité qui fait la promotion d’un produit ou d’un service en s’appuyant sur des arguments environnementaux ne dénigre pas les principes du développement durable puisque, précisément, elle cherche à valoriser ce produit ou ce service par ce biais.
Ainsi, au cas présent, l’association plaignante estime que la campagne valorise le défrichement impliqué par les travaux de terrassement, en dépit de la Recommandation « 1.1 a » précitée. Cependant il doit être observé que les messages litigieux ne font pas la promotion du défrichement en tant que pratique à suivre, mais, au contraire, tendent à nier ou minimiser sa réalité en faisant valoir que les arbres coupés et déracinés se trouvaient sur une friche industrielle et en insistant sur le verdissement du lieu à l’issue des travaux.
L’association plaignante estime ensuite qu’en affirmant que celui-ci répond à un « réel besoin », la promotion du Surfpark incite à des modes de consommation excessifs ou contraires aux principes de l’économie solidaire en contrariété avec la Recommandation en son point « 1.1 b » précitée. Mais, par définition, une publicité a pour finalité de vanter ou promouvoir la consommation d’un bien ou d’un service. Le fait de mettre en avant un espace aquatique artificiel pour la pratique d’un sport, n’est pas en lui-même contraire aux préconisations en matière d’impacts éco-citoyens, de la Recommandation précitée.
L’association plaignante reproche par ailleurs la valorisation du prélèvement d’eau de pluie qui serait contraire à la Recommandation, point « 1.1 c » en ce qu’elle minimiserait les conséquences de sa consommation pour les fossés, les zones humides, les rivières et les fleuves. Cependant, d’abord, la Recommandation visée, en préconisant d’éviter de minimiser les conséquences de la consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement, renvoie plutôt à la consommation de produits nocifs pour l’environnement. Ensuite, au cas présent, les promoteurs du Surfpark de Canéjan, en expliquant qu’est envisagée la récupération de l’eau de pluie pour faire fonctionner son espace aquatique, ne fait pas la promotion de la consommation de cette eau de pluie au détriment des espaces naturels mais entend, au contraire, faire valoir sa préoccupation de minimiser l’impact sur l’environnement en limitant la consommation d’eau potable, ce qui est en effet un objectif louable comme l’admet l’association plaignante elle-même.
L’association plaignante estime enfin qu’en affirmant s’inscrire dans la transition écologique, le projet discrédite les principes et objectifs, ainsi que les conseils ou solutions, communément admis en matière de développement durable en contrariété avec la Recommandation prise en son point « 1.2 » précitée. Cependant, là-encore, il apparaît que les promoteurs de l’académie de la glisse de Canéjan ne discréditent pas les principes et objectifs en matière de développement durable mais, au contraire, se réclament de la transition écologique pour valoriser leur action en montrant leur attachement à cette dernière.
Au total, il en ressort que les allégations relevées par l’association plaignante ne sont donc pas contraires à la Recommandation développement durable précitée s’agissant des impacts écocitoyens.
- Sur la véracité et la clarté des actions :
S’agissant du déboisement, l’association observe que contrairement aux allégations relevées sur le site et dans la vidéo, celui-ci, effectué pour la construction du Surfpark, est avéré. Sur ce point, il ressort des éléments du débat que des arbres ont bien été abattus dans le cadre d’un défrichement qui a été autorisé par la préfète de la Gironde par arrêté du 8 avril 2022, lequel prévoyait d’ailleurs le reboisement d’une surface équivalente dans le massif des Landes de Gascogne dans un délai de trois ans. Aussi, s’il est bien exact, ainsi que l’affirment les promoteurs du Surfpark, qu’au sens strict, le projet n’a pas détruit de « terres naturelles ou agricoles » puisqu’il est réalisé dans une friche industrielle, il est en revanche bien inexact d’affirmer qu’il n’y a pas eu de déboisement, le code forestier ne distinguant pas en fonction de la nature du terrain sur lequel est opéré le défrichement, comme le relève l’association. Il n’est par ailleurs pas justifié, ni établi qu’il y aura davantage d’arbres à l’issue du projet qu’auparavant, contrairement à ce que laisse entendre l’expression utilisée sur le site : « tout en replantant des arbres pour verdir encore plus la zone ».
S’agissant de la qualité de l’eau des bassins susceptible d’être rejetée et qui serait « aussi propre que celle du robinet », les porteurs du projet de l’Académie de la glisse admettent eux-mêmes, dans leurs écritures le caractère « maladroit » de cette formule et proposent d’apporter des corrections au message figurant sur le site internet pour préciser que cette eau fera en effet l’objet d’un traitement pour la rendre compatible avec son usage.
S’agissant de l’autonomie du Surfpark en eau et en énergie, le jury ne peut que relever les contradictions entre certaines expressions employées et relevées par l’association dans le flyer (page 2, bandeau de gauche) : « Ce projet innovant permet une autonomie en eau et en énergie. » et dans les vidéos YouTube (00:48) et vidéo Instagram : « […] c’est vrai que c’est un projet audacieux qui finalement s’inscrit dans la transition écologique grâce à […] la récupération d’eau de pluie ou même station photovoltaïque sur des bâtiments existants pour combler la totalité du besoin » et des expressions figurant dans d’autres parties du site internet, telles que, par exemple, sur la page d’accueil du site du Surfpark : « On vise aussi l’autonomie énergétique pour que le projet soit viable d’un point de vue économique : hors de question de devoir pomper des KwH d’électricité ou des milliers de m3 d’eau qui rendrait le projet non rentable sur le long terme». Et dans leur réponse à la plainte, les porteurs du projet affirment, pour les besoins en eau : « nous avons toujours parlé d’une autonomie pour le maintien des bassins et non pas pour les besoins du bâtiment » et, pour les besoins en électricité : « concernant la consommation électrique, nous parlons d’autonomie en expliquant qu’il faut prendre en compte un lissage annuel de la production d’électricité et de la consommation électrique que nous avons évaluée. »
L’autonomie est ainsi mise en avant en des termes à la fois très affirmatifs et très généraux alors qu’il s’agit, d’une part d’un objectif, d’autre part, d’une autonomie partielle. Il en ressort que le message, par ses contradictions et ses omissions, manque ainsi, sur ce point, de la clarté recommandée au point 4 de la Recommandation précitée, étant observé que si des explications techniques ou données chiffrées sont nécessaires, il est loisible à l’annonceur d’y renvoyer par des notes ou renvois (cf. point 4.3 de la Recommandation).
S’agissant de la norme Afnor XP 52-900 qui spécifie les exigences minimales pour assurer la sûreté de la conception, la construction, l’installation, la maintenance, l’exploitation et le contrôle des installations de vagues pour le surf, il apparaît en effet, aux termes de la vidéo litigieuse, que les porteurs du projet, pour écarter l’application de cette dernière au motif qu’elle conduirait à un gaspillage de la consommation en eau, font valoir, sans en justifier, qu’elle soumettrait les installations à la réglementation des piscines à vagues.
S’agissant enfin des affirmations chiffrées sur la consommation des installations en eau et en électricité (site internet, page intitulée « Questions fréquentes » : « notre Surf Park utilisera moins d’eau qu’une piscine municipale » ; Vidéo (04:39): « En fait, ça consomme l’équivalent de trois voitures électriques qui se rechargent en même temps »), il apparaît que ceux-ci sont, d’après les porteurs du projet, tirés de rapprochement avec les consommations observées dans d’autres installations similaires. Cependant, ces derniers admettent eux-mêmes, dans leur réponse à la plainte, que « les autres parcs Wavegarden ne communiquent pas officiellement sur leurs consommations en eau » et que « le parc de Bristol ne donne qu’une estimation ». Ils ajoutent qu’un expert a été désigné par le tribunal pour éclairer le débat sur ce point et que, s’agissant de la consommation électrique : « nous pourrons à l’avenir être plus clair sur ce point ».
Il en ressort qu’en l’état, l’annonceur n’est pas en mesure de justifier l’ensemble de ses allégations environnementales contrairement à la Recommandation précitée en son point « 2.3 ».
- Sur la proportionnalité des messages :
S’agissant de la référence à l’installation photovoltaïque qui serait le « top de ce qu’on peut faire », il y a lieu de relever, avec les porteurs du projet, que l’expression est sortie de son contexte : l’intervenant ne dit pas dans la vidéo (4’30 environ) que cette installation est le top de ce qu’on peut faire en général et dans l’absolu en matière d’énergie renouvelable ou même de panneaux solaires mais seulement que l’installation de ces panneaux sur des « toitures existantes qui sont des grands bâtiments industriels » correspond à ce qui est préconisé la Société pour l’Étude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, la phrase exacte étant : « c’est vraiment le top de ce qu’on peut faire pour installer une station puisque c’est même ce qui est recommandé par l’association SEPANSO ».
Le message paraît donc proportionné à l’ampleur de l’action menée et promue à cet égard.
S’agissant des nuisances pour les riverains, l’association estime que les allégations de la campagne suggèrent indument l’absence totale d’impact pour les riverains. Mais le fait est qu’ils n’apportent sur ce point aucun élément concret et vérifiable alors que l’installation doit être construite dans une zone industrielle dotée d’un parking, laquelle se trouve à l’écart des zones habitées de Canéjan et à proximité de l’autoroute A 63 (sur laquelle « le trafic varie de 35 000 véhicules/jour au sud à plus de 80 000 à l’approche de la rocade » – chiffres de la DREAL). Les porteurs du projet déclarent en outre que leur installation sera accessible directement depuis l’autoroute, sans passer par les zones habitées de la commune.
Il ne paraît donc pas tout à fait hors de proportion d’affirmer que le Surfpark n’aura pas d’impact négatif pour les résidents de Canéjan, toutes choses égales par ailleurs.
Le Jury observe en revanche que l’allégation du flyer distribué aux habitants : « Ce projet innovant permet une autonomie en eau et en énergie. Il s’inscrit dans la transition énergétique en alliant respect de l’environnement et technologique. », indépendamment de son caractère inexact et peu clair, déjà relevé à propos de la notion d’autonomie en eau et en énergie, trahit un manque de proportionnalité du message publicitaire aux actions réellement entreprises en matière de développement durable dès lors que les installations ne seront pas parfaitement autonomes, d’une part, ni sans aucun impact environnemental, d’autre part (point « 3.2 » de la Recommandation).
- Sur les autres manquements soulevés :
S’agissant de l’utilisation de l’image d’autres structures, les porteurs du projet ont admis un manque de précision, en particulier s’agissant de l’utilisation du logo B-corp qui est la seule pertinente au regard du périmètre de la Recommandation visée et dont la certification n’a en fait pas encore été obtenue alors que le logo a été utilisé dans le flyer, notamment.
Le Jury qui a pris acte de ce que les porteurs du projet l’avaient retiré de la vignette du site instagram du Surfpark, ne peut que constater que son utilisation, y compris dans le flyer distribué aux habitants de Canéjan, n’est pas conforme à la Recommandation prise en son point « 6.2 » puisqu’à ce stade, il ne se rapporte pas au projet promu.
S’agissant des points divers soulevés in fine par l’association qui reproche, pêle-mêle, à nouveau, que « le message exprime sans preuve une promesse globale », qu’il « apparaît souvent disproportionné », « manque parfois de clarté » et qu’enfin, « le vocabulaire utilisé tend à fréquemment gommer l’existence d’impacts négatifs », le Jury observe que ces points ont déjà été examinés à l’occasion des précédents griefs.
Au total, et au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent, le Jury est d’avis que, si tous les griefs avancés par l’association ne sont certes pas fondés, la communication publicitaire qui lui est soumise, contrevient bien partiellement aux dispositions déontologiques précitées en matière de développement durable.
Avis adopté le 10 janvier 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE
I) Instruction
Le Jury de Déontologie Publicitaire (ci-après « le Jury » ou « le JDP ») est saisi, le 18 novembre 2024, d’une plainte par laquelle l’association « Collectif Canéjan en transition » et la Société pour l’Étude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Gironde (ci-après « les plaignantes ») lui demandent de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par divers supports (site Internet, réseaux sociaux, prospectus) pour promouvoir l’implantation d’un Surfpark (ci-après « l’annonceur » ou « Surfpark ») dans la commune de Canéjan, en Gironde.
Par un avis provisoire délibéré le 10 janvier 2025, le Jury estime que la communication publicitaire qui lui est soumise « contrevient partiellement aux dispositions déontologiques précitées en matière de développement durable ».
Les membres du Jury sont saisis, le 27 janvier, par l’annonceur, d’un courrier leur demandant de préciser certains termes de cet avis provisoire, courrier qui, pour le respect du contradictoire, est communiqué aux plaignantes, lesquelles n’y ont pas répondu.
De leur côté, les plaignantes forment parallèlement, et dans les délais requis, un recours en Révision, qui est communiqué à l’annonceur ; ce dernier, en réponse, estime que cette demande de Révision « ne répond pas aux conditions de l’article 22 du règlement intérieur du JDP ».
Le Réviseur de la Déontologie publicitaire (ci-après « le Réviseur ») se rapproche alors de la Présidente du Jury, sous la présidence de laquelle a été adopté l’avis provisoire, et il procède avec elle à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels est fondé cet avis.
Sur ces bases, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes aux demandes des plaignantes et de l’annonceur.
II) Discussion
A) Le recours en Révision des plaignantes est, sur la base de l’Article 22.1-1° du Règlement intérieur du JDP (ci-après « le Règlement »), fondé sur une « critique sérieuse et légitime » de l’avis provisoire.
1) Il ressort de l’avis provisoire que si le Jury n’a certes pas accueilli tous les griefs soulevés par les plaignantes dans leur plainte initiale, il a toutefois établi que « la communication publicitaire qui lui est soumise contrevient partiellement aux dispositions déontologiques précitées en matière de développement durable ».
De manière générale, à partir du moment où un avis du JDP déclare qu’une publicité est non conforme à la déontologie publicitaire, la partie plaignante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le Jury n’a pas répondu à tous ses moyens ou griefs, sauf à démontrer que la non-réponse à l’un de ses griefs entacherait l’avis provisoire d’une erreur manifeste.
Au cas particulier de l’affaire Surfpark, s’agissant de « l’utilisation de l’image d’autres structures », le Jury a considéré que « l’utilisation du logo B-corp, qui est la seule pertinente au regard du périmètre de la Recommandation visée », n’est « pas conforme à la Recommandation prise en son point « 6.2 » » – ce qui constitue l’un des manquements à la déontologie publicitaire retenus par l’avis provisoire à l’encontre de la publicité en cause ; peu importe dès lors que cette utilisation soit, comme le soutient le recours en Révision, également contraire aux dispositions de la Recommandation Développement durable relatives à la véracité des actions.
2) S’agissant de l’application du point 3.3 b/ de la Recommandation Développement durable, il ressort des pièces versées au dossier qu’en dépit de divergences entre les plaignantes et l’annonceur portant notamment sur les distances entre le Surfpark et les plus proches habitations, le recours en Révision n’établit pas que le JDP, en considérant qu’il « ne paraît pas tout à fait hors de proportion d’affirmer que le Surfpark n’aura pas d’impact négatif pour les résidents de Canéjan, toutes choses égales par ailleurs », aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Cette critique de l’annonceur au soutien de la Révision ne peut donc être retenue.
3) Les plaignantes estiment que certains des éléments d’une publicité du même annonceur antérieurement soumise au Jury, et ayant fait l’objet d’un avis du JDP (Affaire Surfpark Canejan n° 1011/24 du 5 août 2024), « réapparaissent » dans la campagne publicitaire du présent dossier (n° 1045/24).
Par suite :
- elles s’interrogent sur l’application, à leur plainte, de l’article 14 du Règlement du JDP ;
- elles demandent au Jury « d’activer une ou plusieurs des possibilités listées à l’article 20.3 de votre règlement intérieur »
L’article 14 prévoit que :
« Lorsque le Jury a accueilli une plainte visant une publicité et qu’il est saisi d’une nouvelle plainte invoquant des griefs analogues à l’occasion d’une nouvelle diffusion de cette publicité, il peut décider :
- soit d’une intervention auprès de l’annonceur lui demandant de ne pas réitérer la publicité. Le plaignant en est informé et invité à consulter l’avis sur le site du JDP ;
- soit d’un examen de la nouvelle plainte.
L’avis du JDP fera mention de la réitération du manquement et pourra être accompagné de l’une ou de plusieurs des mesures prévues à l’article 20.3″.
L’article 20.3, quant à lui, ouvre au JDP « la possibilité :
- de diffuser un communiqué sur son site internet du Jury et/ou un message sur un ou des comptes ouverts sur des réseaux sociaux afin d’assurer une large diffusion de son avis ;
- de transmettre son avis à toute personne intéressée ;
- de demander à l’ARPP une diffusion renforcée de l’avis, par voie de communiqué sur son site internet, par voie d’encart dans la presse, sur le site internet des associations professionnelles représentées à l’ARPP ou par tout autre moyen approprié ;
- de demander à l’ARPP d’intervenir auprès des responsables de la publicité afin de faire cesser le manquement constaté. »
Face à de telles demandes, exprimées dans un recours en Révision, le Réviseur ne peut que faire valoir son incompétence : en effet, aux termes de l’article 22.2 du Règlement, le Réviseur, quand il est saisi d’une demande de Révision, ne dispose que de trois pouvoirs :
- rejeter cette demande ;
- demander au Jury de modifier la rédaction de l’avis, sans toutefois en changer le sens ;
- demander au JDP de procéder à une seconde délibération sur l’affaire en cause.
Cette liste des pouvoirs du Réviseur est clairement limitative : sauf à outrepasser ses attributions, le Réviseur ne peut en aucun cas ordonner au Jury de mettre en œuvre telle ou telle des facultés qui sont offertes au JDP par les articles 14 ou 20.3.
On ajoutera que l’invocation des articles 14 et 20.3 du règlement devrait en tout état de cause être écartée, en application de l’article 22.2-2° dudit règlement, pour avoir été soulevée « pour la première fois au soutien de la demande de Révision », alors qu’elle aurait « manifestement pu sans difficulté être soumise à l’appréciation du Jury lors de l’examen de la plainte initiale ».
4) Les plaignantes demandent en Révision de corriger la rédaction de l’avis provisoire :
- en modifiant la dénomination des « piscines à vagues », car les plaignantes indiquent qu’aucune réglementation propre à de telles piscines n’existe dans le Code de la Santé publique ;
- en précisant que la plainte initiale a été déposée par deux Associations et non par une seule.
Ces deux demandes paraissent fondées.
B) En réponse à la communication qui leur a été donnée de l’avis provisoire, les représentants de l’annonceur ont, dans les délais ouvrant droit à une demande de Révision, demandé au Jury de « préciser » (dans son avis définitif) qu’ils :
- ont déjà intégré la majorité des « modifications importantes demandées » ;
- poursuivent « actuellement des corrections supplémentaires ».
Ces demandes, qui ne sont justifiées par aucune des trois raisons pouvant fonder une demande de Révision (Art 22.1-1° du règlement), ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables.
III) Conclusion
Des analyses qui précèdent il résulte que :
- la demande adressée au Jury pour Surfpark (§ II-B ci-dessus), qui ne se présente pas comme un recours en Révision, est en tout état de cause irrecevable au titre de la Révision ;
- la demande en Révision des plaignantes est recevable et à ce titre sera mentionnée dans la rédaction finale de l’Avis du Jury ;
- la critique sérieuse ou légitime (au sens de l’Article 22.1 du Règlement) invoquée par les plaignantes contre l’Avis provisoire ne peut être considérée comme fondée.
Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.
Il n’y a pas lieu non plus de réformer l’Avis, sauf pour en corriger la rédaction conformément aux observations figurant au § II-A-4) ci-dessus.
Dès lors et pour conclure, l’Avis en cause ainsi corrigé et complété (pour mentionner le recours en Révision et la présente réponse) deviendra définitif et il sera publié – accompagné de la présente décision, laquelle constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande de l’annonceur Surfpark.
Alain GRANGE-CABANE
Réviseur